Dieu n’avait donc pas voulu que Sidi Ali-ben-Mahammed fit son pèlerinage à Oumm el Koura, la mère des cités; peut-être son accident était-il une punition du retard qu’il avait apporté dans l’accomplissement de ce pieux projet. Mais, comme, en résumé, le saint marabout se piquait d’être un parfait mouslim(6), c’est-à-dire résigné à la volonté de Dieu, il se soumit sans se plaindre aux décisions qu’il croyait venir d’en haut. Sidi Bou-Zid avait trois enfants : deux fils et une fille ; il lui vint un jour à l’idée de proposer à Sidi Ali, dès qu’il serait entré en convalescence, de se charger de l’instruction de ses deux fils, jeunes gens qui, d’après leur père, —les pères sont tous les mêmes, — avaient tout ce qu’il faut pour devenir des flambeaux de l’Islam. Or, nous l’avons dit, Sidi Ali était un puits de science : ainsi, qu’on l’interrogeât sur el-êlm er-rebbouniya, qui est la théologie, sur el-êlm elmâana, qui est la rhétorique, sur el-êlm en-nedjoum, qui est l’astronomie, sur el-kimïa, qui est la chimie, sur ettâlimat, qui sont les mathématiques ; qu’on l’interrogeât, disons-nous, sur ces matières, et sur bien d’autres encore, il n’était point du tout embarrassé pour en résoudre les difficultés les plus ardues. De plus, on le citait pour son éloquence et la clarté de sa dialectique : à plusieurs reprises, il avait lutté, et victorieusement, avec les mouchebbiha, ces impies anthropomorphistes qui osent assimiler la nature de Dieu à celle des hommes; avec les tena-soukhiya, secte de métempsychosistes qui croient à la transmigration des
corps humains dans les corps des animaux. Par exemple, comme le Prophète, Sidi Ali avait horreur de la poésie, qu’il qualifiait habituellement de nefts ech-Chithan, souffle de Satan.
Sidi Ali se chargea avec joie de l’instruction des fils de Sidi Bou-Zid ; dès qu’il put sans inconvénient remuer le membre fracturé, il fit appeler les deux enfants, s’arma des insignes du professorat, c’est-à-dire d’un kdhib, qui est une longue et menue baguette destinée à rappeler, par sa mise en relation avec leur dos ou la plante de leurs pieds, l’attention vagabonde et trop souvent égarée des disciples, puis il se mit à les bourrer des principes de toutes les connaissances humaines, depuis le « bism illahi er-rahmani er-rakimi(7) », qui ouvre le Koran, jusqu’aux limites les plus reculées d’el-djebr ou el-mkabla( , qui est la science de l’opposition et de la réduction.
, qui est la science de l’opposition et de la réduction.
Grâce à l’excellence de la méthode de Sidi Ali, et à l’emploi judicieux qu’il savait faire de sa baguette, les deux fils de Sidi Bou-Zid firent des progrès rapides. Il faut dire que, le jour de leur naissance, leur père n’avait pas négligé de leur mettre une fourmi sur la paume de la main(9), pratique qui assure aux nouveau-nés une intelligence et une habileté extraordinaires pour toute leur vie. Aussi, au bout de deux ans d’études, les enfants de Sidi BouZid tenaient-ils l’auteur de leurs jours pour un parfait ignorant, et ils ne
manquaient pas de lui révéler leur découverte toutes les fois qu’ils en trouvaient l’occasion. Voilà pourtant à quoi s’exposent les pères qui veulent avoir des enfants plus savants qu’eux !
Quand les disciples de Sidi Ali-ben-Mahammed en surent autant que lui, il parla de retourner à Saguiet-El-Hamra.
Sidi Bou-Zid, qui avait l’habitude de son savant ami, voulut le détourner de cette idée ; mais, tout en s’excusant de ne pouvoir accéder à son désir, Sidi Ali lui donna à entendre qu’il serait bien aise de revoir son R’arb chéri, dont il était absent depuis plusieurs années, et où il brûlait de se retremper aux sources pures de l’Islam. Pour vaincre sa résistance, Sidi BouZid alla jusqu’à lui offrir la main de sa fille Tounis, une vraie perle qui mordait le jujube avec de la grêle(10), une vierge, — autant qu’une fille peut l’être dans le Sahra, — aux yeux de gazelle, qui serait infailliblement son
dhou el-mekan, la lumière de sa demeure. Sidi Ali devint le gendre de Sidi Bou-Zid, et parut consentir à se fixer auprès de son beau-père ; mais, quelque temps après son mariage, il recommença à parler de son départ. Sidi Bou-Zid, qui n’avait plus de fi lle à lui offrir, et qui, pourtant, tenait plus que jamais à retenir sous sa tente le trop volage marabout, était tout disposé à faire de nouveaux sacrifices pour se l’attacher définitivement. Il lui donna à choisir entre une somme de deux mille dinars et le puits ou la source de Tiouelfln. Sidi Ali n’hésita pas à prendre les deux mille dinars ; mais, le soir même, le marabout ayant été faire ses ablutions aux eaux de Tiouelfl n, le puits, froissé, sans doute, d’avoir été dédaigné, fit sentir à Sidi Ali qu’il avait une bien autre valeur que celle de la somme qu’il avait acceptée de Sidi BouZid, et que l’abondance de ses belles eaux était une fortune pour celui qui saurait les utiliser. Tout en faisant la part de l’amour-propre blessé de ce puits, Sidi Ali, qui s’était mis à réfléchir, vit bien que ce haci n’exagérait pas trop son estimation, et qu’en effet ces magnifiques eaux, qui semblaient de l’argent liquide, étaient un trésor d’autant plus précieux dans le Sahra que ce genre de richesse y est d’une infinie rareté.
Sidi Ali s’empressa de retourner à la tente de son beau-père; il se mit immédiatement en devoir, après s’être assuré qu’il n’était pas observé, de déterrer un vieux vase dans lequel il avait déjà inhumé les deux mille dinars, puis il se présenta à Sidi Bou-Zid, et lui dit, en lui remettant la somme qu’il tenait de sa générosité :
Tâthini Tiouelfi n ;
kheïr men elfi n.
« Tu me donneras Tiouelfin ; cela vaut mieux que deux mille (dinars). »
Sidi Bou-Zid, qui n’avait rien à refuser à son gendre, consentit à reprendre ses deux mille dinars et à lui céder sa source. Ce ne fut pas sans regret que Sidi Bou-Zid fit cette cession à Sidi Ali, et qu’il se dépouilla de ses admirables eaux. Le trop généreux marabout semblait d’ailleurs pressentir ce qui devait lui arriver. En effet, Sidi Ali, qui s’était aperçu de l’attachement qu’avait pour lui son beau-père, songeait déjà à spéculer sur ce sentiment pour rentrer en possession des deux mille dinars qu’il lui avait rendus. Il feignit encore d’être pris de nostalgie, et le seul remède à sa maladie était, selon lui, un prompt retour au pays de ses ancêtres. Le bon Sidi Bou-Zid se mit à bout de ressources pour traiter la nostalgie de son gendre : il pensa qu’une application de dinars dans la main du malade ne pouvait manquer de produire un merveilleux effet. Les deux mille dinars, — toute la fortune de Sidi Bou-Zid, — furent exhumés de nouveau de leur vieille marmite et remis à Sidi Ali, qui les accepta sans difficulté. Sidi Bou-Zid s’était dit : « J’ai tout donné à l’époux de ma fille, et il le sait; il parait avoir un bon cœur ; il est donc hors de doute qu’il pourvoira à mes besoins, besoins qui, d’ailleurs, n’ont rien d’extravagant. »
Les choses allèrent très bien pendant quelques mois; Sidi Ali, qui déjà avait deux enfants de sa femme Tounis, ne parlait Plus de départ; il paraissait, aujourd’hui qu’il avait des intérêts sur le sol, vouloir se fi xer défi nitivement près du Haci-Tiouelfin. Mais Sidi Bou-Zid se faisait vieux, et, comme tous les vieillards, il était rabâcheur. Nous voulons bien admettre que le rabâchage n’a rien de démesurément gai ; mais nous aurions voulu que Sidi Ali le supportât avec plus de patience qu’il ne le faisait, car enfi n son beau-père s’était saigné aux quatre membres pour lui, et la reconnaissance l’obligeait tout au moins à savoir souffrir avec calme, avec déférence, les redites et les quintes du vieillard. Malheureusement, il n’en fut pas ainsi, et, au bout d’un an, Sidi Bou-Zid et Sidi Ali ne pouvaient plus vivre sous la même tente. Le beau-père le comprit, et il résolut de s’éloigner d’un homme dont il n’avait fait qu’un ingrat. Il s’en ouvrit à Sidi Ali, qui ne
chercha pas du tout à le retenir. « Mais où irai-je ? demanda-t-il à son gendre avec des larmes qui, ne trouvant pas à se frayer une issue par leurs conduits naturels, lui retombaient sur le cœur ; où irai-je, vieux et infirme comme je le suis ? » répéta-t-il avec des sanglots capables de fendre l’âme à un rocher qui en eût été pourvu. « Dieu est grand et généreux, lui répondit froidement Sidi Ali, et il ne laisse point périr ses serviteurs ! Monte cette mule, ô le père de ma femme ! et là où elle tombera de fatigue tu y planteras ta tente, car c’est là où Dieu aura marqué le terme de ton voyage. »
La mule dont parlait Sidi Ali avait été autrefois la monture favorite de Sidi Bou-Zid ; elle avait vieilli sous lui, et, depuis longtemps, on ne lui demandait plus rien. Son garrot effacé, son dos caméléonisé et tanné, ses côtes saillantes à faire craindre la déchirure de sa peau, tous ces signes indi-
quaient un âge considérable et des services hors ligne. Au reste, on ne lui donnait guère à manger que pour le principe, et pour lui ôter tout prétexte de plainte quand, au jour de la résurrection, elle devrait paraître, comme tous les êtres créés, devant le tribunal de l’Éternel. La combinaison de Sidi Ali était donc d’une grande habileté, puisqu’il se débarrassait du même coup de son beau-père et d’une mule impotente, Sidi Bou-Zid accepta d’autant plus volontiers l’offre de son gendre qu’il se disait : « La bête n’ira pas loin; donc je serai encore auprès d’eux. »
On habilla donc la vieille mule d’un bât de son âge, qui vomissait sa bourre par de nombreuses blessures ; on y accrocha un vieux mezoued (musette) tout recroquevillé, qu’on emplit de farine d’orge grillée : c’étaient les provisions de bouche du vieux marabout ; puis on le hissa sur sa monture, dont toutes les articulations craquèrent comme une charpente dont les diverses pièces ont considérablement joué. Néanmoins, la mule resta debout, ce qui fit espérer à Sidi Ali qu’elle pourrait mener son beau-père encore assez loin.
Après avoir reçu les adieux et les souhaits de bon voyage de ses enfants et de ses petits-enfants, Sidi Bou-Zid, rapprochant ses deux longs tibias des flancs de l’animal, l’invita, par une pression avortée, à se mettre en route. Le
premier pas était, sans doute, le plus coûteux, car la pauvre mule eut toutes les peines du monde à porter devant l’autre la jambe dont elle avait l’intention de partir. Enfin, après avoir essayé de tourner la tête à droite et à gauche comme pour chercher sa direction, elle se décida, — le demi-tour lui étant de toute impossibilité, — à adopter le cap que le
hasard ou le Tout Puissant avait placé devant elle. Elle avait le nez dans le sud-ouest. Quand le saint marabout se mit en route, on n’était pas
loin de la prière du dhohor(11) ; toute la famille de Sidi Ali en profita pour demander au Dieu Unique de conduire sans accident, et le plus loin possible, leur père et grand-père Sidi Bou-Zid ; ils le prièrent aussi de donner à sa mule la force nécessaire pour remplir sa mission comme ils le désiraient.
A l’heure de la prière de l’âceur, c’est-à-dire plus de deux heures après son départ, on apercevait encore distinctement l’infortuné Sidi Bou-Zid : il allait très lentement ; mais il était toujours sur le dos de sa mule. Et les cœurs des
membres de son excellente famille en bondirent de joie. On sut depuis qu’après avoir marché deux jours et deux nuits sans boire ni manger, la mule de Sidi Bou-Zid avait terminé en même temps sa mission et sa longue carrière au pied des montagnes du Djebel El-Eumour, à la corne Est de ce massif. Puisque c’était la volonté de Dieu, et celle de son gendre surtout, Sidi Bou-Zid s’établit dans une anfractuosité de la montagne, dont il fi t sa kheloua (solitude). On ne sait pas trop comment il y vécut pondant les premiers temps ; mais, sa réputation de sainteté s’étant promptement répandue dans le pays, son ermitage fut bientôt encombré de fidèles qui venaient lui demander d’être leur intercesseur auprès du Dieu unique.
Après une longue existence, toute consacrée à Dieu, Sidi Bou-Zid s’éteignit doucement dans les bras de ses khoddam (serviteurs religieux). Comme son état de sainteté ne faisait pas l’ombre d’un doute, on éleva sur son tombeau la somptueuse koubba qui, aujourd’hui encore, fait l’admiration des Croyants. Ne voulant pas s’éloigner de la dépouille
mortelle du saint homme qui avait été leur puissant intercesseur pendant sa vie, ses khoddam se construisirent près de son tombeau des habitations qui fi nirent par former un ksar, auquel ils donnèrent le nom de Sidi Bou-Zid.
Sidi Ali-ben-Mahammed restait donc le légitime et unique propriétaire de Haci-Tiouelfi n, et, comme cette possession l’avait tout à fait guéri de sa nostalgie, il songea sérieusement à se fixer sur ses eaux. De nombreux disciples, avides d’entendre ses savantes leçons, avaient, d’ailleurs, dressé leurs tentes auprès de la Kheloua du saint marabout, et formaient une sorte de Zaouïa qui comptait déjà des tholba d’infiniment d’avenir.
Sidi Ali, disons-nous, paraissait avoir renoncé à courir le
corps humains dans les corps des animaux. Par exemple, comme le Prophète, Sidi Ali avait horreur de la poésie, qu’il qualifiait habituellement de nefts ech-Chithan, souffle de Satan.
Sidi Ali se chargea avec joie de l’instruction des fils de Sidi Bou-Zid ; dès qu’il put sans inconvénient remuer le membre fracturé, il fit appeler les deux enfants, s’arma des insignes du professorat, c’est-à-dire d’un kdhib, qui est une longue et menue baguette destinée à rappeler, par sa mise en relation avec leur dos ou la plante de leurs pieds, l’attention vagabonde et trop souvent égarée des disciples, puis il se mit à les bourrer des principes de toutes les connaissances humaines, depuis le « bism illahi er-rahmani er-rakimi(7) », qui ouvre le Koran, jusqu’aux limites les plus reculées d’el-djebr ou el-mkabla(
Grâce à l’excellence de la méthode de Sidi Ali, et à l’emploi judicieux qu’il savait faire de sa baguette, les deux fils de Sidi Bou-Zid firent des progrès rapides. Il faut dire que, le jour de leur naissance, leur père n’avait pas négligé de leur mettre une fourmi sur la paume de la main(9), pratique qui assure aux nouveau-nés une intelligence et une habileté extraordinaires pour toute leur vie. Aussi, au bout de deux ans d’études, les enfants de Sidi BouZid tenaient-ils l’auteur de leurs jours pour un parfait ignorant, et ils ne
manquaient pas de lui révéler leur découverte toutes les fois qu’ils en trouvaient l’occasion. Voilà pourtant à quoi s’exposent les pères qui veulent avoir des enfants plus savants qu’eux !
Quand les disciples de Sidi Ali-ben-Mahammed en surent autant que lui, il parla de retourner à Saguiet-El-Hamra.
Sidi Bou-Zid, qui avait l’habitude de son savant ami, voulut le détourner de cette idée ; mais, tout en s’excusant de ne pouvoir accéder à son désir, Sidi Ali lui donna à entendre qu’il serait bien aise de revoir son R’arb chéri, dont il était absent depuis plusieurs années, et où il brûlait de se retremper aux sources pures de l’Islam. Pour vaincre sa résistance, Sidi BouZid alla jusqu’à lui offrir la main de sa fille Tounis, une vraie perle qui mordait le jujube avec de la grêle(10), une vierge, — autant qu’une fille peut l’être dans le Sahra, — aux yeux de gazelle, qui serait infailliblement son
dhou el-mekan, la lumière de sa demeure. Sidi Ali devint le gendre de Sidi Bou-Zid, et parut consentir à se fixer auprès de son beau-père ; mais, quelque temps après son mariage, il recommença à parler de son départ. Sidi Bou-Zid, qui n’avait plus de fi lle à lui offrir, et qui, pourtant, tenait plus que jamais à retenir sous sa tente le trop volage marabout, était tout disposé à faire de nouveaux sacrifices pour se l’attacher définitivement. Il lui donna à choisir entre une somme de deux mille dinars et le puits ou la source de Tiouelfln. Sidi Ali n’hésita pas à prendre les deux mille dinars ; mais, le soir même, le marabout ayant été faire ses ablutions aux eaux de Tiouelfl n, le puits, froissé, sans doute, d’avoir été dédaigné, fit sentir à Sidi Ali qu’il avait une bien autre valeur que celle de la somme qu’il avait acceptée de Sidi BouZid, et que l’abondance de ses belles eaux était une fortune pour celui qui saurait les utiliser. Tout en faisant la part de l’amour-propre blessé de ce puits, Sidi Ali, qui s’était mis à réfléchir, vit bien que ce haci n’exagérait pas trop son estimation, et qu’en effet ces magnifiques eaux, qui semblaient de l’argent liquide, étaient un trésor d’autant plus précieux dans le Sahra que ce genre de richesse y est d’une infinie rareté.
Sidi Ali s’empressa de retourner à la tente de son beau-père; il se mit immédiatement en devoir, après s’être assuré qu’il n’était pas observé, de déterrer un vieux vase dans lequel il avait déjà inhumé les deux mille dinars, puis il se présenta à Sidi Bou-Zid, et lui dit, en lui remettant la somme qu’il tenait de sa générosité :
Tâthini Tiouelfi n ;
kheïr men elfi n.
« Tu me donneras Tiouelfin ; cela vaut mieux que deux mille (dinars). »
Sidi Bou-Zid, qui n’avait rien à refuser à son gendre, consentit à reprendre ses deux mille dinars et à lui céder sa source. Ce ne fut pas sans regret que Sidi Bou-Zid fit cette cession à Sidi Ali, et qu’il se dépouilla de ses admirables eaux. Le trop généreux marabout semblait d’ailleurs pressentir ce qui devait lui arriver. En effet, Sidi Ali, qui s’était aperçu de l’attachement qu’avait pour lui son beau-père, songeait déjà à spéculer sur ce sentiment pour rentrer en possession des deux mille dinars qu’il lui avait rendus. Il feignit encore d’être pris de nostalgie, et le seul remède à sa maladie était, selon lui, un prompt retour au pays de ses ancêtres. Le bon Sidi Bou-Zid se mit à bout de ressources pour traiter la nostalgie de son gendre : il pensa qu’une application de dinars dans la main du malade ne pouvait manquer de produire un merveilleux effet. Les deux mille dinars, — toute la fortune de Sidi Bou-Zid, — furent exhumés de nouveau de leur vieille marmite et remis à Sidi Ali, qui les accepta sans difficulté. Sidi Bou-Zid s’était dit : « J’ai tout donné à l’époux de ma fille, et il le sait; il parait avoir un bon cœur ; il est donc hors de doute qu’il pourvoira à mes besoins, besoins qui, d’ailleurs, n’ont rien d’extravagant. »
Les choses allèrent très bien pendant quelques mois; Sidi Ali, qui déjà avait deux enfants de sa femme Tounis, ne parlait Plus de départ; il paraissait, aujourd’hui qu’il avait des intérêts sur le sol, vouloir se fi xer défi nitivement près du Haci-Tiouelfin. Mais Sidi Bou-Zid se faisait vieux, et, comme tous les vieillards, il était rabâcheur. Nous voulons bien admettre que le rabâchage n’a rien de démesurément gai ; mais nous aurions voulu que Sidi Ali le supportât avec plus de patience qu’il ne le faisait, car enfi n son beau-père s’était saigné aux quatre membres pour lui, et la reconnaissance l’obligeait tout au moins à savoir souffrir avec calme, avec déférence, les redites et les quintes du vieillard. Malheureusement, il n’en fut pas ainsi, et, au bout d’un an, Sidi Bou-Zid et Sidi Ali ne pouvaient plus vivre sous la même tente. Le beau-père le comprit, et il résolut de s’éloigner d’un homme dont il n’avait fait qu’un ingrat. Il s’en ouvrit à Sidi Ali, qui ne
chercha pas du tout à le retenir. « Mais où irai-je ? demanda-t-il à son gendre avec des larmes qui, ne trouvant pas à se frayer une issue par leurs conduits naturels, lui retombaient sur le cœur ; où irai-je, vieux et infirme comme je le suis ? » répéta-t-il avec des sanglots capables de fendre l’âme à un rocher qui en eût été pourvu. « Dieu est grand et généreux, lui répondit froidement Sidi Ali, et il ne laisse point périr ses serviteurs ! Monte cette mule, ô le père de ma femme ! et là où elle tombera de fatigue tu y planteras ta tente, car c’est là où Dieu aura marqué le terme de ton voyage. »
La mule dont parlait Sidi Ali avait été autrefois la monture favorite de Sidi Bou-Zid ; elle avait vieilli sous lui, et, depuis longtemps, on ne lui demandait plus rien. Son garrot effacé, son dos caméléonisé et tanné, ses côtes saillantes à faire craindre la déchirure de sa peau, tous ces signes indi-
quaient un âge considérable et des services hors ligne. Au reste, on ne lui donnait guère à manger que pour le principe, et pour lui ôter tout prétexte de plainte quand, au jour de la résurrection, elle devrait paraître, comme tous les êtres créés, devant le tribunal de l’Éternel. La combinaison de Sidi Ali était donc d’une grande habileté, puisqu’il se débarrassait du même coup de son beau-père et d’une mule impotente, Sidi Bou-Zid accepta d’autant plus volontiers l’offre de son gendre qu’il se disait : « La bête n’ira pas loin; donc je serai encore auprès d’eux. »
On habilla donc la vieille mule d’un bât de son âge, qui vomissait sa bourre par de nombreuses blessures ; on y accrocha un vieux mezoued (musette) tout recroquevillé, qu’on emplit de farine d’orge grillée : c’étaient les provisions de bouche du vieux marabout ; puis on le hissa sur sa monture, dont toutes les articulations craquèrent comme une charpente dont les diverses pièces ont considérablement joué. Néanmoins, la mule resta debout, ce qui fit espérer à Sidi Ali qu’elle pourrait mener son beau-père encore assez loin.
Après avoir reçu les adieux et les souhaits de bon voyage de ses enfants et de ses petits-enfants, Sidi Bou-Zid, rapprochant ses deux longs tibias des flancs de l’animal, l’invita, par une pression avortée, à se mettre en route. Le
premier pas était, sans doute, le plus coûteux, car la pauvre mule eut toutes les peines du monde à porter devant l’autre la jambe dont elle avait l’intention de partir. Enfin, après avoir essayé de tourner la tête à droite et à gauche comme pour chercher sa direction, elle se décida, — le demi-tour lui étant de toute impossibilité, — à adopter le cap que le
hasard ou le Tout Puissant avait placé devant elle. Elle avait le nez dans le sud-ouest. Quand le saint marabout se mit en route, on n’était pas
loin de la prière du dhohor(11) ; toute la famille de Sidi Ali en profita pour demander au Dieu Unique de conduire sans accident, et le plus loin possible, leur père et grand-père Sidi Bou-Zid ; ils le prièrent aussi de donner à sa mule la force nécessaire pour remplir sa mission comme ils le désiraient.
A l’heure de la prière de l’âceur, c’est-à-dire plus de deux heures après son départ, on apercevait encore distinctement l’infortuné Sidi Bou-Zid : il allait très lentement ; mais il était toujours sur le dos de sa mule. Et les cœurs des
membres de son excellente famille en bondirent de joie. On sut depuis qu’après avoir marché deux jours et deux nuits sans boire ni manger, la mule de Sidi Bou-Zid avait terminé en même temps sa mission et sa longue carrière au pied des montagnes du Djebel El-Eumour, à la corne Est de ce massif. Puisque c’était la volonté de Dieu, et celle de son gendre surtout, Sidi Bou-Zid s’établit dans une anfractuosité de la montagne, dont il fi t sa kheloua (solitude). On ne sait pas trop comment il y vécut pondant les premiers temps ; mais, sa réputation de sainteté s’étant promptement répandue dans le pays, son ermitage fut bientôt encombré de fidèles qui venaient lui demander d’être leur intercesseur auprès du Dieu unique.
Après une longue existence, toute consacrée à Dieu, Sidi Bou-Zid s’éteignit doucement dans les bras de ses khoddam (serviteurs religieux). Comme son état de sainteté ne faisait pas l’ombre d’un doute, on éleva sur son tombeau la somptueuse koubba qui, aujourd’hui encore, fait l’admiration des Croyants. Ne voulant pas s’éloigner de la dépouille
mortelle du saint homme qui avait été leur puissant intercesseur pendant sa vie, ses khoddam se construisirent près de son tombeau des habitations qui fi nirent par former un ksar, auquel ils donnèrent le nom de Sidi Bou-Zid.
Sidi Ali-ben-Mahammed restait donc le légitime et unique propriétaire de Haci-Tiouelfi n, et, comme cette possession l’avait tout à fait guéri de sa nostalgie, il songea sérieusement à se fixer sur ses eaux. De nombreux disciples, avides d’entendre ses savantes leçons, avaient, d’ailleurs, dressé leurs tentes auprès de la Kheloua du saint marabout, et formaient une sorte de Zaouïa qui comptait déjà des tholba d’infiniment d’avenir.
Sidi Ali, disons-nous, paraissait avoir renoncé à courir le

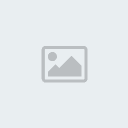



 من طرف Admin الأربعاء أبريل 30 2008, 20:58
من طرف Admin الأربعاء أبريل 30 2008, 20:58